Extrait de « Un conte de deux digues » (« A Tale of Two Dykes »)
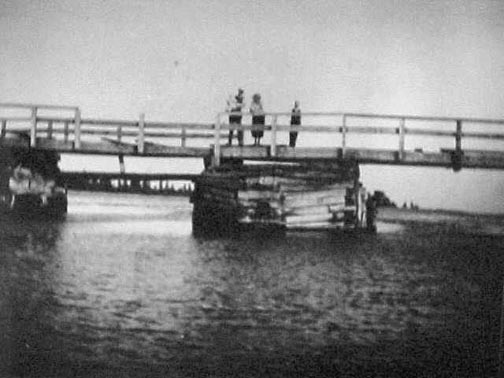
Audio : Extrait de « Un conte de deux digues » (« A Tale of Two Dykes ») de Margaret Kuhn Campbell, 1979, p. 50 – 53. Édité et lu par Cindy Campbell-Stone.
Image : [19-?]. Album de Margaret (Kuhn) Campbell. Archives de la Cole Harbour Rural Heritage Society.
Transcription:
Margaret Kuhn Campbell est la fille de Peter McNab Kuhn, septième et dernier propriétaire de la digue de Cole Harbour. Margaret Kuhn Campbell est l’auteure d’un livre intitulé « Un conte de deux digues » (« A Tale of Two Dykes »), publié en 1979. Je lirai un extrait de ce livre, des pages 50 à 53 approximativement. J’ai adapté et légèrement changé ses paroles pour les besoins de cette lecture. Je m’appelle Cindy Campbell-Stone (aucun lien de parenté) et je suis honorée de lire les écrits de Margaret Kuhn Campbell.
« Mon père, Peter McNab Kuhn, avait l’intention d’élever des bovins de boucherie dans le marais. Les différentes espèces d’herbe allaient servir de nourriture pour élever le bétail, sinon pour l’engraisser. La ferme située plus haut dans les terres avec ses petites zones de pâturage était complémentaire. Le bœuf qui est élevé maigre et engraissé par la suite est de bonne qualité, car sa chair est jeune et tendre, me dit-on. Au cours des 26 années suivantes, la carrière de Peter s’inscrit dans cette voie. L’effort n’a jamais été lucratif. L’argent servait aux besoins essentiels et pour se payer quelques gâteries. Cependant, grâce au dévouement et au travail acharné des deux parents, la famille a été élevée en bonne santé.
Comme propriétaire de la digue, Peter a dû faire face à deux défis d’importance au cours d’une carrière qui s’est avérée être un combat constant. L’un d’entre eux fut la nécessité d’améliorer les portillons d’écoulement, ou l’aboiteau, afin de mieux drainer le port. Avec son esprit inventif, il avait un plan pour y parvenir, qui a été mis à exécution.
Mon frère affirme, de mémoire, que les portes de huit pieds de large, suspendues au centre d’ouvertures de douze pieds avec des cloisons rigides de deux pieds de large de chaque côté, avaient perdu leur capacité de flotter sur la marée montante. Elles avaient aussi été recouvertes de grandes plaques de cuivre en guise de ballast, pour qu’elles puissent résister à la prochaine inondation. Peter retira les cloisons, omit les plaques de cuivre et ferma complètement chaque ouverture avec un jeu de deux portes de six pieds de large chacune. Le nouveau système était meilleur et Peter fut récompensé pour ses efforts. Comme le dit son frère Wilfrid : « Il a retiré les plaques de cuivre et a fait des portes plus larges, ce qui a permis d’empêcher l’eau de pénétrer. »
L’autre défi que mon père devait relever chaque printemps était les dommages causés à l’aboiteau par les forces de la nature. La violence des tempêtes hivernales et les glaces qui venaient percuter les portes et leur charpente de soutien lors du dégel printanier endommageaient chaque fois la structure, parfois de façon presque catastrophique. Les portes étaient arrachées, les caissons endommagés. Une fois, la digue de l’est fut percée et il fallut trois semaines de travail pour la réparer. Il était généralement possible de récupérer les portes sur le rivage à l’extérieur du port; on les réparait et on les remettait en place. Les caissons nécessitaient parfois de nouvelles planches et de nouvelles roches de remblai. Ce travail devait s’effectuer au début du printemps dans l’eau glacée; parfois, en raison de l’urgence de la situation, les ouvriers devaient marcher dans l’eau pour avoir un meilleur point de vue. Mon père s’était sans doute réservé cette tâche, car on m’a dit qu’on l’avait vu avec de l’eau glacée jusqu’à la taille.
Les hommes de la maison, le père et ses deux fils, devaient conduire le lourd chariot agricole pendant huit kilomètres sur la route de West Lawrencetown jusqu’à l’aboiteau, même quand les garçons étaient très jeunes. Au gré des opportunités qu’offrait la marée, ils devaient travailler toute la journée et revenir la nuit, arrivant souvent tard le soir et repartant tôt le lendemain matin pour une autre journée ardue. Quelles que soient les actions immédiates requises pour prévenir les dommages que pourraient causer le vent et les vagues, il fallait y faire face à la force des bras.
De temps en temps, les voisins, propriétaires des plus petits lots du marais, aidaient à réparer la digue, mais ils étaient impressionnés par le travail des garçons. L’une des tâches assignées aux garçons consistait à ramasser des roches pour remplacer celles perdues lors des dommages causés aux caissons. Ils furent très fiers lorsque des ouvriers, observant les énormes roches qu’ils avaient apportées et leur petit gabarit, leur demandèrent avec étonnement : « Comment avez-vous réussi à les soulever? » Le secret des garçons, des plus astucieux, fut de fabriquer à l’aide de lourdes planches une rampe pour rouler les rochers sur le chariot.
Vous savez, j’étais une petite fille à cette époque et je n’ai jamais réalisé l’ampleur des difficultés que mon père et mes frères devaient surmonter, jusqu’à ce que je l’ai découvert, avec étonnement, lors d’une conversation récente avec mon dernier frère qui vit maintenant en Floride en permanence.
Cette scène montre le cabanon de sa maison mobile de Fort Lauderdale, entouré de magnifiques pelouses et d’arbustes et de ses bananes, oranges et papayes suspendues aux arbres. Un grand tulipier chinois couvert de fleurs, dont les branches pointent vers le ciel et répandent leurs pétales roses sur le toit et la pelouse, donne un très joli effet.
Mais, vous savez, l’évocation des souvenirs a été éprouvante, parfois ardue, et a suscité une charge émotionnelle plus forte que nous ne le réalisions l’un et l’autre. Wilfrid se souvient de quelque chose qui me semble pratiquement incroyable.
« Nous travaillions toute la journée, faisions le long chemin du retour et arrivions à la maison à dix heures du soir. Nous nous couchions… pour nous lever à quatre heures du matin pour recommencer. »
Incapable de poursuivre, il s’est levé et éloigné, luttant pour maîtriser l’émotion qui le mettait mal à l’aise. Ne voyez aucun signe d’amertume dans ces paroles, seulement du chagrin pour le petit garçon qu’il était et qui devait faire face aux difficultés quotidiennes. Avec le recul, j’imagine notre mère, obligée de réveiller ses jeunes fils à cette heure indue pour les envoyer vivre une autre expérience que les enfants ne devraient pas avoir à vivre. Bien sûr, elle leur fournissait tout le confort possible en termes de nourriture et de vêtements chauds, mais elle était impuissante face aux difficultés que devaient vivre ses fils, Wilfrid, âgé d’environ huit ans et Max, l’aîné de la famille, âgé de treize ans.
Ce long combat a heureusement pris fin suite à un acte de violence, extrêmement rare à cette époque rurale paisible : le « bombardement » de l’aboiteau, comme on l’appela, en 1917. Mais c’est là une autre histoire
(Image : L’aboiteau de Cole Harbour montrant la largeur des portes. Des inconnus sont appuyés à la rambarde.)

